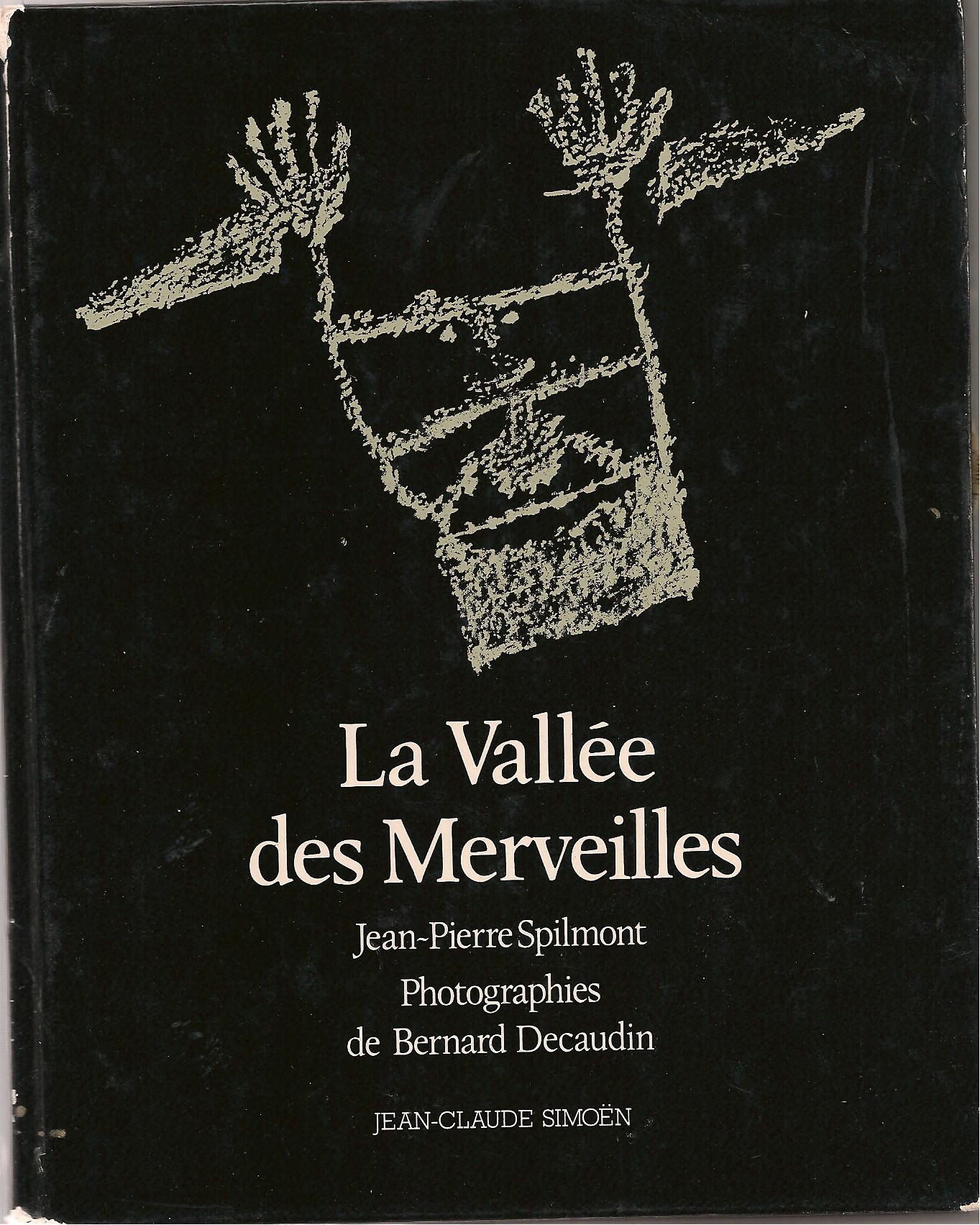
« Dans un livre qui n’est pas un recueil de
poèmes, mais l’évocation d’un lieu, La Vallée des
Merveilles, Jean-Pierre Spilmont a écrit un
véritable
‘Art poétique’. Quand il parle de cette montagne où des
bergers gravèrent , il y a quatre mille ans, des milliers de
figures, il parle tout simplement de la poésie, de sa
signification, de ses enjeux. […]. Aimer l‘œuvre d’un poète
amène à y accéder par diverses «
entrées ». La Vallée des Merveilles est ma
préférée. Elle fait de Jean-Pierre Spilmont un
berger de tous les temps et de partout : du mont Bego, de Savoie,
d’Ouessant, de Lozère. Un homme en proie au mystère de la
fragilité et de la durée. Un poète qui, avec
inquiétude et émerveillement, laisse une trace dans les
pierres».
Michel Besnier, Aube
Magazine, N° 40, 1990
« Ce serait donc l’histoire d’un homme. Rien
qu’un
homme qui cheminerait sur une route. A moins qu’il ne soit tel enfant
longeant la plaie où le monde s’est un jour
déchiré. Il y aurait des arbres nus, des rochers, des
corps aussi, comme douloureux de s’être offerts apeurés,
au songe des caresses. Et cet homme regarderait. Bien sûr il te
ressemblerait et, pour une fleur cueillie sur un dôme de marnes (
te souviens-tu, c’était devant nous la courbe d’un sein
cependant que nous rêvions tout haut de disparaître
là, frôlant éternellement cette terre pareille au
ventre à peine bombé d’une femme… ), pour une parole
soudain tandis qu’il en allait d’être du parti de la tendresse,
cet homme me rappellerait qu’il ne faut pas céder. Malgré
les pluies. Les gels. Malgré l’envie de tout laisser fuir, grain
de sable trop lourds au maintenant entre les doigts qui voulurent s’y
noyer. »
Lionel Bourg, Aube
Magazine, N° 40, 1990
« Avec Jean-Pierre Spilmont, quelle que soit
l’envolée, l’amplitude du souffle, nous ne sommes jamais loin de
nos sols, de nos chemins. « L’idée-chair » dont il
parle si fortement dans un de ses premiers recueils, L’Orée, la
déchirure, affirme une alliance, une sensibilité dont il
ne se départira jamais. Les chemins de Jean-Pierre Spilmont
s’élèvent sans s’égarer; ses silences s’emplissent
d’échos sans se disperser. Nous traversons avec lui des espaces
fertiles; nous rencontrons des êtres, un visage : « comme
un labour, comme une étrange nuit, comme un arbre… ». Il
faut non seulement lire les mots de Jean-Pierre Spilmont, mais encore
les vivre. Il faut les laisser nous imprégner, nous animer; ce
sont de solides et rigoureux compagnons.»
Andrée Chedid,
Aube Magazine, n°40, 1990
« Jean-Pierre, je t’écris dans un
jardin
peuplé de roses trémières et de cosmos. Cette
fleur au nom d’univers. J’ai planté mon regard sans
humilité, avec beaucoup de désirs, sur la crête de
Tirith Mir. 8000 mètres à escalader d’un seul mouvement
de l’œil. Heureux dans ce paysage, je pense Balmat, ton »Balmat
le minéralier », homme « mélangé aux
fées » pour avoir obtenu d’elles la permission
d’accéder à leur sphère, de trouer la
barrière d’interdits qui protégeait le fait du
Mont-Blanc. Je pense à tes mots de montagnard, rompus à
l’ascension de l’espoir. Parce que tu es homme qui descend de la
montagne avec les tables de la joie.»
Jean-Yves Loude,
lettre de Chitral, Pakistan, Aube
Magazine, n°40, 1990
« C’est en 1975 qu’a paru ce livre
décisif et
fondateur, L’autre je, chez Henri Fagne ( grand petit éditeur
disparu auquel il faudrait un jour rendre hommage).Ce livre, par la
répartition des mots sur la page, par les figures noires et
blanches que créent les décalages et les espacements, par
le rapport des italiques, des capitales et bas-de-casse, met en
scène visuellement une déchirure de l’espace verbal, qui
marque durablement le lecteur. Une expérience du
dépouillement se déroule ici en direct et pratiquement,
page après page. [...]. Les livre de Jean-Pierre Spilmont nous
conduisent là et il nous faut, avec eux, y résister
à l’illusion d’un en-dehors, d’un au-delà.»
Bernard Noël,
à propos de “Vers un matin sans
cicatrice”
« Jean-Pierre Spilmont, amoureusement et sans
relâche, traque l’instant précis où
cédèrent les glaces immémoriales des gisants
d’avant la parole. A la rigueur des temps, il voudrait opposer le jaillissement du sens, instantané
mais porteur de sa durée, de sa patience, et donc d’un futur. Dans
ces
étapes
à
peine
inscrites
sur la page, nul oubli de la
violence biologique, de la sauvagerie voire de la rapacité
primordiale, et donc une vraie loyauté. Proche encore de
révoltes essentielles, ou déjà transmuée en
écoute sans illusion
ni
refus,
cette
rudesse
échappe
au jugement éthique. Elle
est simplement constitutive du poète et de son lecteur.»
Bernard Simeone,
préface à « ... Dans
le désert du sang »
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________